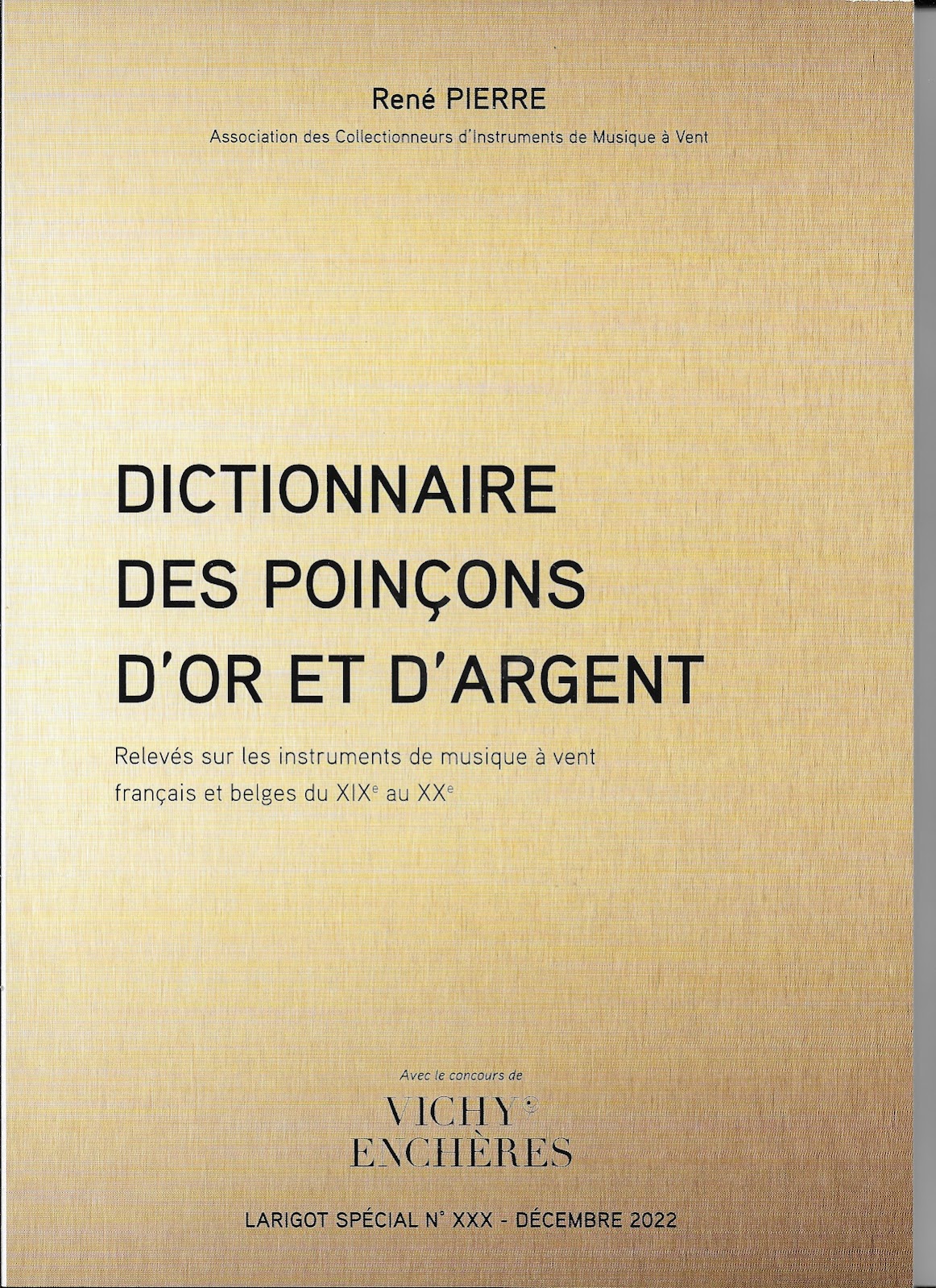par
José-Daniel Touroude
Introduction
— Une relation structurante
Depuis les premiers sons que l’Homme a organisé et ritualisé
jusqu’aux concerts diffusés sur les plateformes mondiales, la musique a
toujours été bien plus qu’un simple art du divertissement. Peu à peu certaines
personnes qui avaient des prédispositions ont eu un rôle particulier de
musicien pour accompagner les différentes manifestations de la vie et en fait
le groupe, qui le libérait d’une partie des tâches, devenait mécène. Dans
certaines communautés plus larges où le surplus et la richesse pouvait le
permettre, certaines sociétés ont pu financer l’amélioration des prestations
musicales, le temps ainsi dégagé pouvant être consacré à l’entraînement allant
jusqu’à une certaine spécialisation. Peu à peu la musique était incontournable et
les musiciens sont alors captés par les dirigeants. La musique devenait et devient
ainsi un moyen de persuasion, de cohésion et de rayonnement d’une communauté
mais surtout un langage lié au pouvoir des puissants et des dirigeants.
Instruments de musique en ivoire
En face de ces pouvoirs qu’ils soient religieux, politiques, économiques ou technologiques, le musicien a une place particulière dans la société avec un statut fragile. Il a toujours dû composer avec la dépendance : dépendance financière, sociale ou symbolique. Le couple musicien–mécène constitue ainsi l’un des fils rouges de l’histoire culturelle de l’humanité. L’artiste incarne la tension entre deux pôles la liberté créatrice qui l’anime et la contrainte matérielle pour les musiciens surtout professionnels. Son image est souvent contrastée (parfois méprisé comme amuseur, saltimbanque, pauvre parfois adulé comme un demi dieu par le public et demandant des cachets faramineux) et la réussite est parfois bien déconnectée de la connaissance de la musique et du talent. Une « star » me disait : mon secret « surfer sur la mode, se mettre au niveau de ce que veut un public et avoir un bon agent est plus important que des longues et difficiles études au conservatoire »
Ce paradoxe fécond de l’alliance ambiguë entre musique et pouvoir traverse les civilisations. De la Mésopotamie à Hollywood, de la chapelle papale aux scènes numériques, il révèle la permanence d’un équilibre instable : le pouvoir soutient et protège, mais attend en retour reconnaissance, prestige ou influence.
 |
| Concert à l'Élysée |
Bien avant
les cours royales d’Europe, le lien entre musique et pouvoir s’enracine dans le
sacré. En Mésopotamie, les
prêtres-musiciens étaient les médiateurs de l’ordre cosmique ; en Égypte, les
hymnes au pharaon divinisé rythmaient le cycle des saisons et affirmaient la
continuité dynastique. En Grèce, la musique participait à l’éducation morale et
civique qui devait façonner l’âme, l’ordre dans la cité et l’harmonie du
cosmos. Rome, quant à elle, institutionnalisa les musiciens comme membres de
collèges professionnels, au service du culte et de la célébration du pouvoir
impérial.
Cette association de la musique à la légitimité religieuse ou politique se
retrouve dans toutes les civilisations anciennes : des musiciens de cour
chinois aux griots d’Afrique de l’Ouest, gardiens de la mémoire des lignées
royales. Au Moyen Âge européen, l’Église devient le principal mécène. Les cathédrales et les monastères abritent des
maîtrises où se forment chanteurs et compositeurs. Le chant grégorien, la
polyphonie, les motets témoignent d’une organisation institutionnelle où la
musique sert la liturgie, mais aussi le prestige du pouvoir ecclésiastique. Les
musiciens entre eux se regroupent en corporations comme les facteurs
d’instruments à vent ou les luthiers.
Le musicien courtisan de la Renaissance et du Baroque
Avec la Renaissance s’affirme l’humanisme et, avec
lui, la montée du mécénat princier. Les cours italiennes, françaises et
germaniques deviennent les lieux de pouvoir de l’Art en général où musique,
peinture et architecture participent d’un même projet politique : la représentation du pouvoir. (Exemple
Florence des Médicis). Le compositeur devient un serviteur prestigieux : Josquin
des Prez à la cour des Sforza, Palestrina au Vatican, Monteverdi
à Mantoue. Les musiciens se déplacent de cour en cour, négociant leur statut,
leurs privilèges et leur reconnaissance et certains sont de véritables stars
solistes (exemple des castrats).
Sous le règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Lully
incarne la fusion parfaite entre art et absolutisme. Compositeur, directeur
d’institution et véritable ministre officieux de la musique, il met son talent
au service du Roi-Soleil. Les
ballets de cour et les tragédies lyriques deviennent des dispositifs politiques
: ils encadrent les émotions collectives, exaltent la hiérarchie et
transforment la musique en instrument d’ordre.
Mais cette période voit aussi émerger des tensions nouvelles. Certains artistes, comme Heinrich Schütz
ou Henry Purcell, cherchent à concilier service institutionnel et voix
personnelle. Le musicien courtisan doit séduire sans se trahir, obéir sans
s’effacer. Certaines villes riches rivalisent avec les puissants et possèdent
aussi leurs compositeurs-musiciens talentueux souvent organistes (exemple JS Bach)
 |
JS Bach à l’orgue |
Le XVIIIᵉ siècle bouleverse les
rapports entre art et pouvoir. La diffusion des idées des Lumières et la montée de la
bourgeoisie cultivée créent un nouvel espace : les salons, lieux d’échanges intellectuels et musicaux où les mécènes
sont aussi des amateurs avertis (musique de chambre, époque Biedermeier à
Vienne)
 |
Concert en famille à la maison au XVIIIème siècle |
Le musicien
n’est plus seulement un serviteur : il devient un créateur doté d’une personnalité propre. Joseph Haydn, au
service des Esterházy, jouit d’une stabilité rare, mais aussi d’une liberté
artistique réelle. Mozart, lui, incarne la tentative d’émancipation :
refuser le statut de domestique pour vivre de son art, entre concerts publics
et édition musicale. Son échec relatif souligne la difficulté de cette
indépendance naissante. Beethoven et bien d’autres feront la navette entre
mécènes qui imposent des œuvres à jouer et la liberté de composer et jouer ce
que le musicien désire.
C’est aussi à cette époque que naît le public
moderne. Les sociétés de concert, les abonnements, la presse musicale
ouvrent la voie à une forme de mécénat
collectif. Le musicien devient auto entrepreneur, et le goût du public
commence à peser autant que celui des princes.
La musique
et la culture devient affaire d’Etat et de la fonction publique au XIXᵉ
siècle
La Révolution française et la montée des États-nations
redéfinissent la place du musicien. L’art devient un outil de construction identitaire : les conservatoires, les opéras
nationaux, les orchestres publics structurent le paysage musical. Être
musicien, c’est désormais servir la collectivité, éduquer le peuple par des
œuvres faciles qui amènent à la connaissance du grand répertoire et des œuvres
plus complexes.
Mais cette fonction publique coexiste aussi avec la
naissance du capitalisme culturel.
L’édition musicale, les tournées et la presse ouvrent un marché concurrentiel. L’artiste
devient une marque, une entreprise itinérante avec des agents organisateurs de
tournées et de concerts. Franz Liszt et Niccolò Paganini
incarnent la figure du virtuose-star,
libre de tout mécène, financé par le public et les entrepreneurs. Le musicien
navigue alors entre la politique publique et les entrepreneurs privés.
 |
| N. Paganini |
La musique est intégrée à une politique culturelle idéologique de l’Etat au XXᵉ siècle
Le XXᵉ siècle voit la politisation accrue de la musique voire un outil de propagande.
Dans les régimes totalitaires, l’artiste est à la fois exalté et surveillé. Chostakovitch
incarne tragiquement cette ambivalence : obligé de plaire au régime soviétique
tout en glissant dans ses œuvres des messages de résistance. En Allemagne
nazie, la musique devient un instrument de hiérarchisation raciale et
d’exclusion notamment des artistes juifs et communistes.
Aucune histoire des relations entre musique et pouvoir ne serait complète sans le jazz, né dans les marges sociales et raciales de l’Amérique. Issu des traditions afro-américaines, il se développe d’abord hors des institutions, dans des réseaux communautaires et informels. Ses premiers acteurs vivent de l’économie du spectacle populaire, dans les champs, les rues. Certains sollicitent la générosité collective avec le « chapeau » d’autres jouent pour leur plaisir sans aucune contribution monétaire.
Rapidement, des lieux regroupent musiciens et mélomanes dans les clubs, cabarets et étendent leurs publics grâce aux enregistrements. Toute musique à la mode devient économiquement intéressante. Les grandes maisons de disques et les organisateurs de spectacles façonnent le marché. Le jazz devient aussi un instrument diplomatique : pendant la Guerre froide, les États-Unis envoient Duke Ellington ou Dizzy Gillespie en tournée mondiale pour incarner la liberté américaine face au réalisme soviétique.
En 1962 en
pleine guerre froide, tournée triomphale de Benny : le soft power
américain en action
Dans les années 1960–1970, une nouvelle génération de
musiciens revendique l’indépendance : Charles Mingus, Sun Ra, Ornette
Coleman ou les collectifs de Chicago réinventent des formes d’autogestion
musicale. Labels coopératifs, festivals communautaires et mécénat participatif
préfigurent les modèles alternatifs d’aujourd’hui.
Le mécénat
privé et l’industrie culturelle contemporaine
Celine Dion à las Vegas (durée des prestations 16 ans) record pour Elton Jones 17 ans !
Artistes
indépendants et contre-pouvoirs
Pouvoirs publics contemporains : entre soutien et
normalisation
Dans de
nombreux pays européens, l’État reste un acteur central du soutien à la musique. Les systèmes de
subvention, les résidences, le statut des intermittents ou les commandes
publiques permettent une relative stabilité. Ce modèle garantit la diversité et
la continuité, mais il engendre aussi des tensions : standardisation administrative, hiérarchies implicites des genres, concurrence entre patrimoine et
création contemporaine.
Ailleurs, le soutien public relève du soft
power. Les monarchies du Golfe financent des orchestres et des festivals
prestigieux pour affirmer leur modernité culturelle. En Asie de l’Est, la Chine
et la Corée du Sud investissent massivement dans l’éducation musicale et les
concours internationaux comme instruments de rayonnement. Dans les démocraties
libérales, la question se pose désormais en termes de gouvernance culturelle : comment soutenir sans orienter ? Comment
protéger la création tout en respectant sa liberté ?
Perspectives numériques et mondialisation
Le XXIᵉ
siècle a ouvert un chapitre inédit : celui du mécénat numérique. Les plateformes de financement participatif
(Patreon, Kickstarter, Ulule) permettent un lien direct entre artistes et
publics. Le soutien devient plus horizontal, plus intime, mais aussi plus
volatil.
La mondialisation crée une visibilité
inédite, mais aussi une homogénéisation des formats. Pour exister sur la
scène internationale, beaucoup d’artistes adaptent leur esthétique aux normes
du marché global. La musique devient un produit transnational où l’identité
locale est souvent réinterprétée pour séduire un public planétaire. De plus en
plus on croise dans un concert plusieurs genres musicaux pour plaire à
tous : des « tubes » du classique, des airs jazzy de comédies
musicales, des airs de variétés connus, des musiques de films célèbres…
Certains musiciens contemporains naviguent entre utopie d’autonomie et réalisme
économique : les anciens mécènes sont remplacés par des algorithmes, investisseurs et audiences globales. La liberté
apparente se paie d’une exposition permanente à la concurrence mondiale.
Le mécène et le clarinettiste du futur
Le mécénat : contrainte ou moteur créatif ?
Faut-il voir
dans cette dépendance historique une entrave ou une source d’inspiration ?
En réalité, le mécénat a souvent été un
moteur créatif. Sans les commandes religieuses, pas de messes de
Palestrina ; sans les commandes royales, pas d’opéras de Lully, ni de Haendel,
sans les obligations de fournir des pièces d’orgue et des cantates tous les
dimanches au temple pas de JS Bach, sans les subventions publiques, pas de
créations de Boulez ou de Stockhausen. Le pouvoir impose un cadre, mais ce
cadre stimule souvent l’invention.
Conclusion — Une histoire de
dépendance créatrice