par José‑Daniel Touroude
Depuis plus de trente ans, j’arpente brocantes, maisons de vente et réserves de musées pour dialoguer avec celles et ceux qui collectionnent les instruments à vent. L’enquête initiale auprès de collectionneurs d’instruments à vent, bâtie autour de douze questions, a livré un matériau important : anecdotes savoureuses, confessions parfois intimes, considérations techniques ou philosophiques. Afin de rendre cette richesse accessible, j’en propose aujourd’hui une synthèse fidèle et résumée. Le lecteur découvrira comment une passion fait office de refuge et de moteur, comment elle dialogue avec l’argent et le temps, et pourquoi les collectionneurs, loin d’être de simples accumulateurs, sont des passeurs de mémoire et de savoir.
Question
1 – Pourquoi la passion du collectionneur reste‑t‑elle
intacte ?
La
passion naît souvent d’un choc esthétique : la première fois que l’on tient
entre ses mains certains instruments emblématiques comme le saxo ténor mark 6
de Stan Getz ou la clarinette centered tone de Benny Goodman, nous avons un
choc sensoriel qui imprime durablement la mémoire. Dès lors, chaque rencontre
avec une autre pièce apparentée réactive la sensation initiale. L’objet
convoqué n’est plus seulement un instrument, il devient la clef d’accès à un
état émotionnel rare, presque originel.
 |
| Saxophone alto Grafton. Charlie Parker a joué sur ce type d'instrument. |
Or
cette émotion n’agit pas seule ; elle se combine à la stimulation
intellectuelle. Pour authentifier une estampille, il faut éplucher de vieux
catalogues, comparer des détails de fabrication, discuter avec des experts,
réactiver l’histoire de la musique dans son contexte. À chaque mystère résolu,
le plaisir esthétique s’enrichit d’une satisfaction cognitive. Ainsi, la
passion mêle jouissance immédiate et construction méthodique : l’une réchauffe
le cœur, l’autre nourrit l’esprit.
Article sur le saxophone Grafton de Charly Parker
Enfin,
la passion se régénère par l’alternance du calme et de la quête. Le moment de
contemplation, face à une vitrine silencieuse, recharge l’énergie que l’on
dépensera plus tard en voyage, en négociation, en restauration. Quand la
curiosité faiblit, le simple fait de faire sonner un vieil instrument ranime la
flamme. Cette circulation permanente explique qu’après des décennies, le
collectionneur ressente encore la même palpitation qu’au premier achat. Et puis
nous sommes aux aguets, toujours prêts pour le prochain achat, la prochaine
découverte.
Le graal du collectionneurs de clarinettes : 3 clarinettes Stengel dans leur boite d'origine
Question 2 – Pourquoi une collection n’est‑elle jamais « terminée » ?
L’incomplétude tient d’abord au choix
du terrain de jeu. En se spécialisant, par exemple, dans les clarinettes
françaises du XIXᵉ siècle, on croit restreindre l’horizon. Pourtant, ce cadre
contient des centaines de modèles, de facteurs, de variantes régionales. Chaque
découverte ouvre deux pistes supplémentaires. Plus le collectionneur apprend,
plus il prend conscience de ce qu’il ignore. Ensuite, le désir se nourrit du
manque. Tant qu’un instrument rêvé échappe, il agit comme un appât mental. Les
marchands le savent et entretiennent la tension en évoquant des pièces «
sorties d’un grenier ». Lorsque l’objet finit par arriver et acheté, la satisfaction
est brève ; presque aussitôt un autre chaînon manquant se dessine. Ce
déplacement perpétuel préserve l’élan.
Certains collectionneurs affirment
clore un chapitre une fois un corpus jugé complet. Ils ne renoncent pas pour
autant : ils déplacent la focale. Après avoir réuni tous les styles de
saxophones de la période Sax, ils se penchent sur les partitions d’époque ou
sur les becs originaux. L’inachevé n’est pas une faille mais un principe vital.
 |
| Quelques une des inventions d'A. Sax Source Musée Selmer |
Question 3 – Quel est le véritable
statut de l’objet collectionné ?
D’un point de vue fonctionnel, la
plupart des instruments pourraient encore sonner après restauration. Cependant,
le collectionneur les considère avant tout comme des témoins : témoins d’une
innovation, d’une esthétique, d’une société, d’une histoire. Ainsi, un simple
piston innovant d’un cuivre ou une nouvelle clé d’une flûte racontent les
progrès de l’industrialisation autant qu’ils annoncent les instruments
modernes.
Sur le plan symbolique, l’objet agit
comme un miroir. Posséder une pièce rarissime confère au détenteur le statut de
découvreur puis de gardien. Le lien affectif résulte du temps passé à chercher,
puis à soigner la pièce : vernis, soudures invisibles, bois ciré, clés
repolies… Chaque minute investie
augmente la valeur sentimentale.
Enfin, l’objet déclenche du récit. À
l’occasion d’une visite, le collectionneur raconte comment il a repéré
l’instrument sur une petite annonce, comment il a été la chercher, comment il a
triomphé d’une enchère téléphonique. Le récit lie l’objet à l’expérience vécue
parfois mouvementée fait de la collection non un simple stock mais à une
véritable épopée.
L' histoire méconnue des pianos Victory.
Question 4 – D’où viennent les
motivations ?
Les motivations s’agrègent en couches successives. La première est souvent émotionnelle : un souvenir d’enfance, un parent musicien, une harmonie de village, la marque de l’instrument que l’on joue. À ce socle intime s’ajoute la fascination technique ; comprendre pourquoi une modification d’une perce colore un timbre et cela transforme l’amateur en chercheur. À mesure que grandit la collection, la dimension patrimoniale prend le relais. Conserver une flute intacte, c’est empêcher qu’un jalon disparaisse. Le collectionneur se voit alors comme un maillon dans la chaîne de transmission, ce qui confère à sa quête une résonance civique. Dans un monde de consommation rapide, sauver un objet fragile qui a demandé tant de savoir-faire équivaut à un acte de résistance culturelle.
Enfin, la reconnaissance joue son
rôle. Être sollicité par un musée, voir son nom au bas d’une notice
d’exposition, validera l’effort solitaire. Loin de l’orgueil, cette
reconnaissance rassure et prouve que la passion n’est pas vaine, qu’elle
irrigue un savoir collectif. En fait nous avons une utilité sociale car en
collectionnant nous protégeons le patrimoine.
Buffet-Crampon : 200 ans d'existence
 |
| José Daniel Touroude et René Pierre. |
Question 5 – Peut‑on esquisser des profils ?
Un premier profil, le musicien‑collectionneur, part de la pratique.
Il possède plusieurs instruments jouables, les utilise pour des concerts sur
instruments d’époque, compare les réponses acoustiques. Sa collection est un
laboratoire sonore. À l’opposé, le chineur‑revendeur
privilégie la chasse. Il écume marchés et ventes, retape, revend pour financer
la prochaine trouvaille. Pour lui, l’objet circule car vendable ; seuls restent
dans sa collection les spécimens jugés incontournables.
Le restaurateur voit, dans chaque
instrument abîmé, un défi, un challenge ! L’instrument n’est complet que
lorsqu’il est digne d’admiration et /ou s’il rejoue. Enfin, le chercheur‑iconographe amasse photos, partitions,
catalogues afin de replacer l’objet dans son contexte. Bien sûr, la plupart
d’entre nous mélangent ces rôles suivant les périodes de la vie et les moyens
disponibles.
Une rare clarinette de J.G. Geist
Question 6 – Comment la passion se
transforme‑t‑elle en expertise ?
L’expertise naît de la comparaison. Après avoir manipulé cinquante flûtes traversières, on repère instinctivement la main d’un facteur ou l’empreinte d’une copie. Cette compétence se renforce lorsqu’on documente chaque pièce : photos macro, prises de cotes, recherches d’archives. Le catalogue personnel devient base de données. Parallèlement, l’échange alimente la progression. Un forum spécialisé, un groupe de restaurateurs, une visite dans les réserves de musée offrent des contre‑points. Les erreurs se corrigent, les certitudes se nuancent et accroît la réputation de l’expert, qui sera ensuite sollicité par les institutions.
 |
| Pavillon d'une clarinette en ivoire de C. Sax. Met de New York |
Enfin, la vulgarisation consolide le
savoir : écrire un article oblige à clarifier la découverte ; construire une
exposition pousse à hiérarchiser les pièces. Ainsi, la passion, en se donnant à
voir, passe du statut de hobby à celui de compétence reconnue.
Question 7 – Quelle place l’argent
occupe‑t‑il ?
L’argent est un carburant et un garde‑fou. Sans budget, point d’acquisition ; mais un budget illimité tue le plaisir du défi. Souvent les collectionneurs fixent un plafond annuel et prévoient une « réserve » pour l’occasion exceptionnelle. La négociation est un art qui flatte l’ego : arracher un instrument à un prix raisonnable après une joute verbale procure presque autant de joie que l’objet lui‑même. Toutefois, chacun garde en mémoire un achat impulsif — facture trop salée, instrument trop abîmé — qui sert de leçon.
Article sur les ventes d'instruments de musique de Vichy
Quant à la revente, elle est rarement
spéculative. On cède des doublons pour financer une autre pièce, on vend un
lot pour résoudre un besoin familial. Les profits éventuels restent dans le
circuit (plus souvent aux organisateurs d’enchères et revendeurs d’ailleurs).
Au terme d’une vie, peu envisagent la collection comme un placement ; beaucoup
souhaitent qu’elle rejoigne un musée ou sert pour un jeune musicien ou pour un
autre collectionneur méritant, car rarement les collections intéressent les
enfants pour une transmission héréditaire !
Question 8 – Le collectionneur
est‑il vraiment solitaire ?
Il contemple seul, certes, mais toute sa stratégie repose sur le collectif. Les marchands constituent la première courroie : ils préviennent discrètement leurs clients fidèles qu’un instrument rare arrive. Les pairs forment ensuite un réseau d’échange : photos, mesures, conseils de nettoyage, on débat d’une datation, on identifie une contrefaçon. La sociabilité culmine dans la vente aux enchères : chacun observe les concurrents, tente de deviner jusqu’où ils monteront. L’après‑vente rétablit la camaraderie : on va boire un verre, on compare les trophées.
 |
| Marque Clarinette Schemmel (coll J.D. Touroude |
Enfin, le public, qu’il
s’agisse d’étudiants ou de visiteurs d’un salon, redonne sens au travail
accompli. Montrer sa collection, c’est accepter le regard de l’autre, recevoir
des questions naïves, placer l’instrument dans son contexte historique et
musicologique, parfois apprendre aussi qu’un instrument que l’on croyait unique
existe ailleurs.
L' histoire des clarinettes Schemmel
Question 9 – Quel
rapport entretient‑il
avec le temps ?
Restaurer, c’est suspendre la dégradation et cataloguer, c’est figer en un document l’essentiel de nos savoirs. Le collectionneur se bat contre l’entropie. Quand il polit un pavillon, il rend au cuivre son éclat de 1880 ; quand il remet un tampon en peau, il réactive une vibration. Mais le temps est aussi anxiogène : que deviendront ses pièces après lui ? Certains rédigent un document de succession : liste des instruments, estimation, souhait de destination. Certains concluent des accords pour donner à des musées ; d’autres cherchent un collectionneur privé digne de recueillir la collection, d’autres vendent aux enchères avant leur disparition.
Cette projection
élargit encore la signification de la collection : d’aventure personnelle, elle
devient patrimoine. On passe après avoir amassé pendant des décennies à
transmettre le patrimoine.
Question 10 – Où finit la passion, où commence la compulsion ?
Les psychiatres parlent
de collectionnisme quand l’accumulation envahit l’espace vital et détruit le
lien social. Les signes de dérive : endettement chronique, privation des
besoins familiaux, incapacité à vendre même un doublon, refus de toute sortie
qui ne soit pas utile à la collection. Les
collectionneurs que j’ai interrogés eux voient plutôt un curseur qui, la
plupart du temps, reste sous contrôle. À l’inverse, ce sont des signes
d’équilibre : budget limité, stockage sécurisé, partage régulier (articles,
concerts, prêts), acceptation de céder une pièce pour financer un projet
familial.
Article sur les cannes musicales
La conscience du risque
joue un rôle prophylactique. Se savoir susceptible de basculer aide à maintenir
la garde. Et puis le réseau rappelle à l’ordre : un ami qui dit ‘tu n’en as pas
déjà trois ?’ vaut parfois toutes les thérapies.
Question 11 – Pourquoi tant
d’importance accordée à la mise en scène ?
Une vitrine bien éclairée est un appareil de lecture : en plaçant les instruments du plus ancien au plus récent, on visualise l’évolution de la facture. L’ordre n’est donc pas manie, il est outil pédagogique. La mise en scène protège : supports, hygromètre, verre anti‑UV. Elle valorise : un public conquis acceptera plus volontiers d’écouter l’histoire détaillée d’un piston si la pièce brille comme un bijou. Enfin, elle récompense l’effort : contempler trente ans de quêtes alignées dans un meuble sur mesure procure une paix intense.
Certains vont plus loin :
scénarisations sonores, QR codes menant à des enregistrements, associations
d’archives photographiques. Le collectionneur devient alors commissaire
d’exposition, et sa maison un musée miniature.
Question 12 – Au fond,
quel sens le collectionneur donne‑t‑il à sa pratique ?
Trois constantes
émergent.
Premièrement, la
conscience de sauver un patrimoine fragile. Dans une société où l’obsolescence
est rapide, sauvegarder un instrument rare est un acte presque politique.
Deuxièmement, la quête
d’identité : en se construisant une spécialité — tel facteur, telle époque — le
collectionneur se définit et se distingue. Son musée personnel devient un peu
son autoportrait.
Lien sur un article concernant les flageolets de Bainbridge
Troisièmement, la joie
simple de la beauté. Savoir qu’un tube de bois poli, peut encore vibrer deux
siècles après sa naissance, rappelle que l’ingéniosité humaine n’est pas vaine.
Ainsi, collectionner revient à célébrer l’artisan, l’artiste et la matière —
et, accessoirement, à relier le passé et l’avenir par la musique.
Conclusion
En parcourant les douze
questions, on mesure que la collection d’instruments n’est ni caprice, ni
simple accumulation. Elle est un dialogue permanent entre l’émotion et la
connaissance, entre le refuge et l’ouverture, entre le passé préservé et le
futur imaginé. Chaque instrument sauvé, qu’il rejoigne un pupitre pour un
concert ou qu’il reste muet derrière une vitre, prolonge la chaîne des artisans
et des musiciens. Le collectionneur, souvent discret, devient alors médiateur :
il recueille, restaure, raconte et transmet. Sa passion, à condition de rester
équilibrée, offre au patrimoine sonore une seconde vie et au public une fenêtre
inattendue sur l’histoire.
Tant qu’un jeune
visiteur pourra se pencher sur un instrument, imaginer le souffle d’un soldat
de 1870 qui a soufflé dedans, la mission sera accomplie. Dans la lumière
tamisée d’une vitrine ou dans l’éclat d’une scène de concert, l’instrument
retrouvera sa voix et avec lui, résonnera la jubilation du collectionneur.














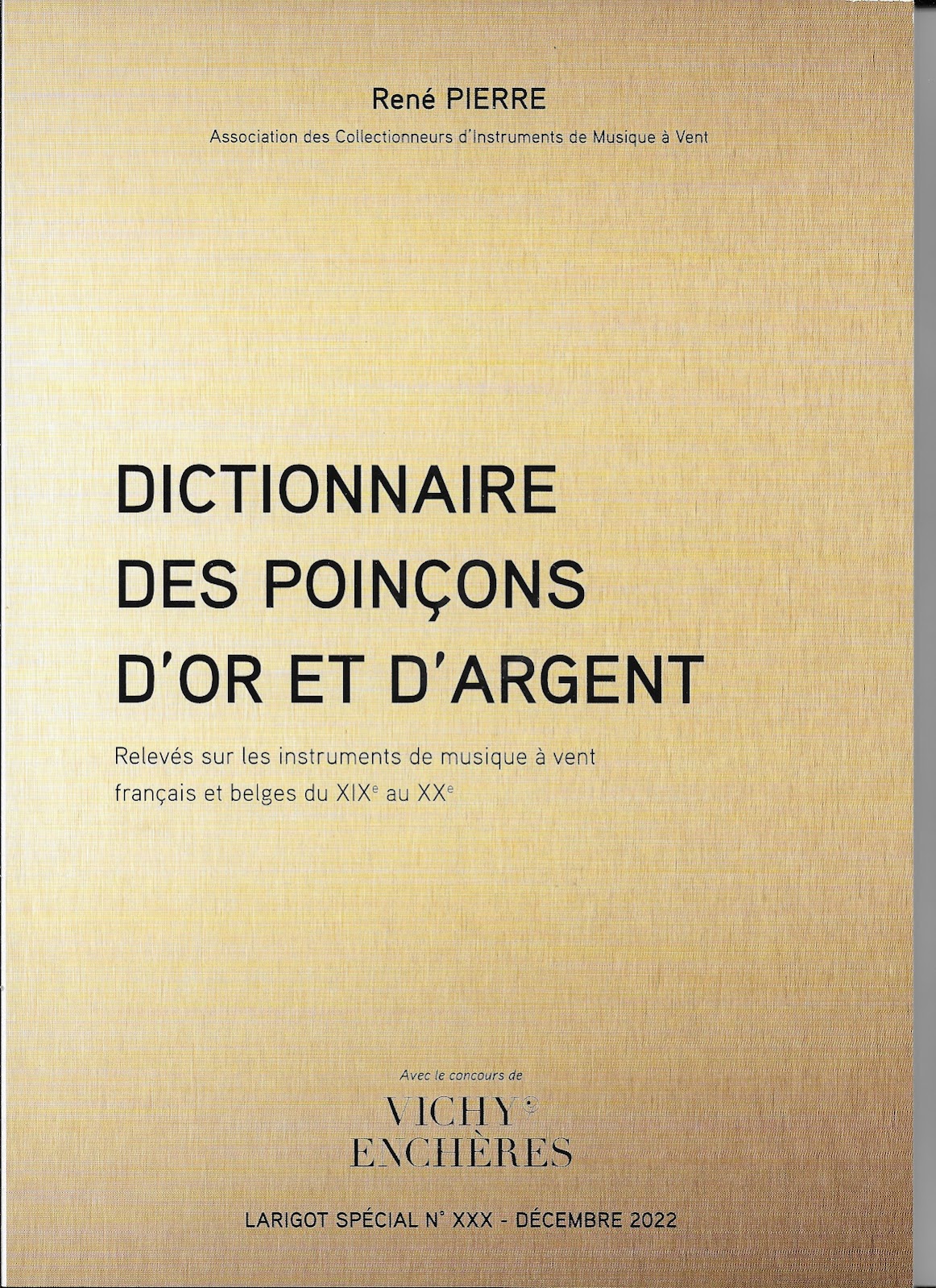
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire