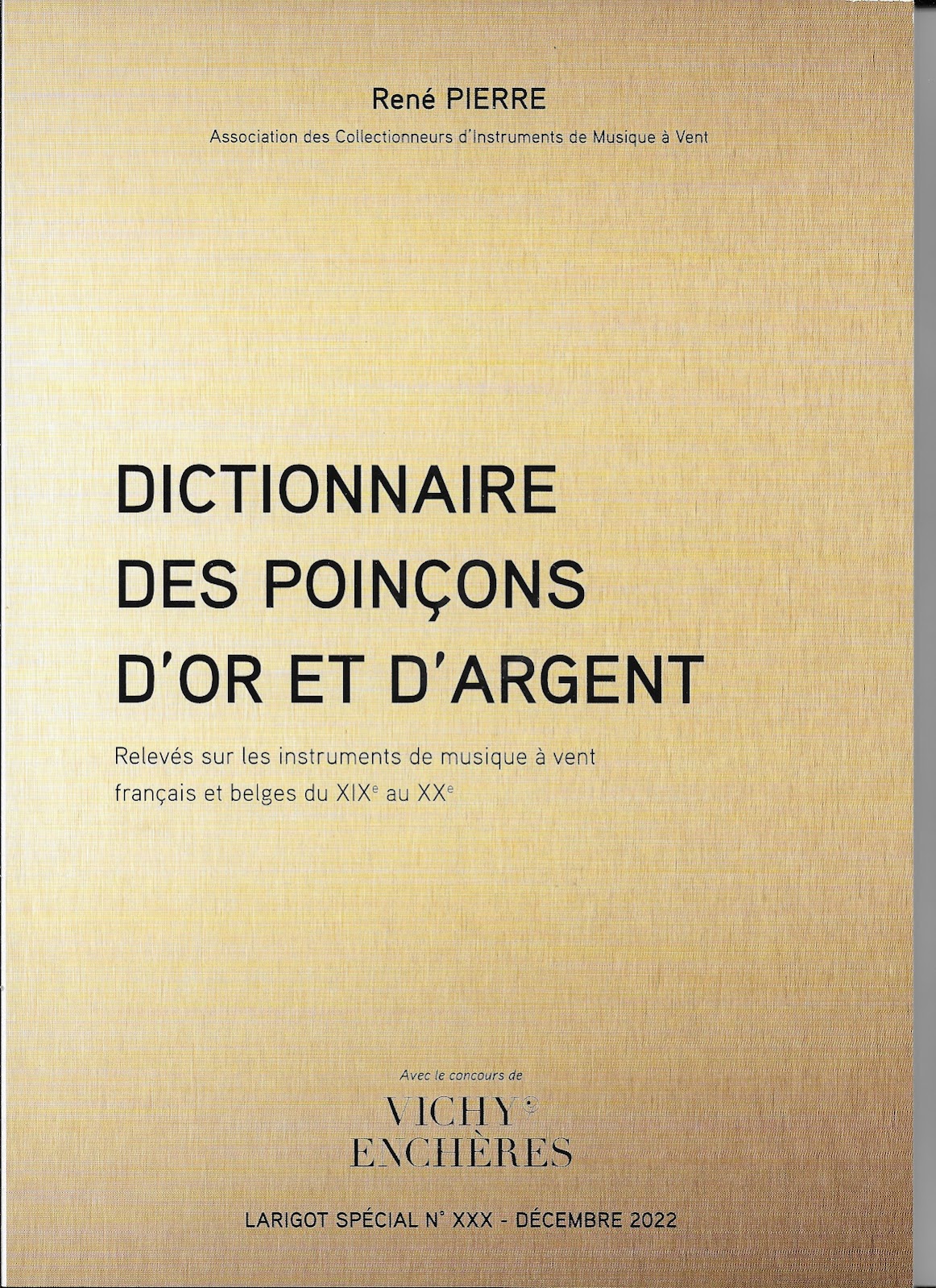Nous venons d'apprendre le décès de la maman de J.D. TOUROUDE qui apparaissait dans cet article avec son enthousiasme et son dynamisme, passionnée de musique.
Nous présentons à José Daniel et à toute sa famille nos sincères condoléances.
Amitiés José Daniel.
Réflexion croisée
entre les expériences et le ressenti d’une chorale d’anciens et quelques explications
des neurosciences.
Le
foyer logement de Saint Georges de Didonne (17) près de Royan est réputé pour
son cadre, au bord de l’Atlantique, par sa qualité de gestion et de services à
la personne , mais aussi par sa chorale véritable centre de gravité des
résidents. Donnons la parole dans un tour de table aux participants avec
la question simple : Pourquoi
chantez-vous et quelle importance a cette chorale pour vous ? Cette réunion est un exercice
collectif pour trouver les mots clefs, les idées essentielles pour analyser
leurs ressentis et voir leurs correspondances avec les neurosciences.
1°) « La
musique a une action sur ma santé
qu'il est fondamental de préserver » nous indique une quasi centenaire.
« Je ne pense
plus à
mes douleurs, à l’ennui, à la solitude car en chantant je m’extériorise, je pense à autre chose, à ma partition, au prochain concert, j’évacue mes problèmes quotidiens
et j’améliore mon bien être » dit
un autre choriste.
« Pourquoi
je chante en chorale, alors que je n’ai fait que fredonner seule toute ma
vie ? pour une simple raison : la musique me devient aussi
essentielle que de respirer et ma
santé s’améliore " indique une autre participante. « Pour moi
il faut de la musique avant toute chose
comme le disait le poète Verlaine. Depuis
que je chante je vieillis moins vite,
du moins j’ai cette impression, et le stress de vieillir baisse assurément"
« De
la musique jusqu’à la fin pour vivre mieux et plus vieux, j’en suis convaincue
car je l’expérimente depuis longtemps ! Notre chorale nous permet de lutter contre l’échéance finale.
Beaucoup de nos membres disparaissent, la moyenne d’âge de ce foyer logement
est de 87 ans, mais quand on chante, je peux vous dire que nous n’avons plus le même âge, des
plaisanteries, même grivoises, fusent et on a bien sûr un homme qui nous
fait rire ! Quand je chante le stress
de vieillir diminue. »
La musique a une fonction thérapeutique et aide à combattre la maladie et à ralentir la perte de motricité. Le pouvoir de la musique est neuroprotecteur et possède des vertus médicinales.
Les
neurosciences ont prouvé que le cerveau mélomane permet de retarder les
maladies dégénératives (notamment Alzheimer, sclérose, maladies
cardiaques..)
L’hormone
cortisol responsable du stress diminue. Chanter permet de bien respirer et de
soulager le stress de vieillir. Chanter sur scène oblige à se dépasser et à
puiser dans les réserves assoupies. Pourquoi
le professeur de musique fait faire des respirations ventrales avant de
commencer à chanter ? car respirer c’est mobiliser son ventre qui est un deuxième
cerveau (vu le nombre important de neurones dans cette région : 200
millions) et cela fournit aussi l’oxygène.
 |
| Différentes zones du cerveau concernées par le type de musique. |
2° « La musique a une
action dynamique
pour
moi et en plus je renforce mon estime de
moi car je suis fière de faire une activité intelligente et nouvelle à mon
âge. »
« Moi je chante pour le plaisir, pour me faire plaisir et faire plaisir. Quand je chante ma tête est légère et je suis bien, je prends du plaisir. »
« Pour moi, c’est dur souvent de démarrer mais j’ai plus de tonus surtout après les répétitions et les concerts. Regardez le film « Buena vista social club» avec ces vieux cubains passionnés qui ont traversé tous les aléas et souffrances de la vie mais qui n’ont jamais abandonné la musique, ou le film « I feel good » avec une chorale de personnes âgées proche de ce qu’on fait ici et qui montre que la musique accompagne toutes nos vies et devient source de régénération"
« Nous devenons plus réactives et plus toniques : j’en oublie ma canne quand je chante, car c’est la musique qui me porte » indique une autre.
Je respire mieux et je me décontracte aussi car j’ai vraiment envie de chanter, c’est comme un massage dynamisant. »

Quand
on joue de la musique, les échanges entre synapses s’accélèrent et plusieurs
neurotransmetteurs interagissent. Les
neurotransmetteurs sont libérés par les neurones qui agissent sur d’autres neurones
qui sont connectés réalisant ainsi une véritable réaction en chaine qui innerve
le cerveau. Selon
la nature du neurotransmetteur, il va inhiber ou exciter les neurones,
le cerveau et tout le corps.
Ainsi
l’imagerie médicale du cerveau a indiqué que la dopamine irrigue le cerveau
et notamment la zone de plaisir.
Il
existe plusieurs familles de neurotransmetteurs : les
catécholamines : (dopamine, noradrénaline, adrénaline) mais aussi la
sérotonine, l’acide glutamique, l’histamine, les endorphines proche des opiacés
connus par les sportifs etc…
Plusieurs
aires cérébrales sont réorganisées par la musique intensive que ce
soit par l’écoute et/ou la pratique musicale.
L’émotion nait souvent de la répétition, la joie étant liée aussi au tempo. Si on fait passer une IRM à un musicien, l’imagerie cérébrale montre que les zones cérébrales sont activées comme lors des stimulations biologiques fortes positives.
En écoutant et/ou en pratiquant de la musique, on se dynamise et on est heureux de vivre pleinement et pas au ralenti. (la sérotonine est liée à la bonne humeur). La maitrise respiratoire en captant plus d’oxygène est aussi (comme le sport) un bon exercice de longévité. La musique est neurostimulatrice, elle engendre un dynamisme et en travaillant la musique, les neurones se reconnectent comme quand on est en pleine activité professionnelle. La pratique régulière de la musique modifie la structure même du cerveau, sa plasticité, et en activant régulièrement certaines zones, elle développe certaines parties. Le cerveau s’adapte à l’instrument que l’on joue (expérience de Schneider en Allemagne) et en jouant avec les autres, en les écoutant (orchestre, chorale), on s’adapte sans cesse. Ainsi chez le musicien les deux hémisphères du cerveau sont mieux connectés et communiquent mieux que chez le non musicien. Et l’estime de soi et la fierté constituent une véritable source d’activation pour le cerveau qui redonne la forme.

3°) « Chanter
c’est encore vivre, respirer, avoir des émotions, chanter des airs qui rappellent des
souvenirs heureux
mais c’est aussi dépasser ses
inhibitions et sa timidité qui nous recroquevillent quand on vieillit car
peu à peu on perd confiance en soi,
en ses aptitudes passées. En
chantant en chorale on prouve à soi même
et aux autres que nous pouvons faire encore des activités ».
« La
passion
est source de jouvence, dira une autre choriste, et la musique, quand les autres passions se sont éteintes progressivement,
demeure. Nous écoutons tous plus de
musique qu’avant, j’ai même écouté un opéra en entier à la TV (la flute
enchantée) ce qui ne m’était jamais arrivé! voilà comment on passe de la
chansonnette à Mozart. Je n’ai pas eu la chance d’avoir une éducation musicale,
étant de conditions modeste et ayant travaillé jeune, mais je me rattrape. Notre
prof et amie nous fait chanter des variétés de notre jeunesse mais introduit de
plus en plus de la musique classique (j’adore chanter Gounod !) et je regrette
de ne pas avoir travaillé ma voix mais il n’est pas trop tard pour chanter
et prendre du plaisir. »
 |
| CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR AGRANDIR. |
Il
faut un environnement musical intense et précoce. Les neurosciences pensent que
c’est essentiel pour formater le cerveau. Mais on peut faire la même analyse
avec les sportifs et autres comédiens ! (influence de la famille, école…)
mais on a prouvé que l’on peut apprendre à tout âge, la création de neurones étant continue.
Le
son crée une pression dans l’oreille qui est un réceptacle qui va activer le
cerveau (lobe temporal derrière l’oreille) en transformant le son en signal
électrique puis chimique, puis une autre zone sera activée situé dans le lobe
frontal, lieu des souvenirs et de la mémorisation, puis une autre zone est
activée la zone de plaisir et de récompense, enfin toute la superficie du
cerveau est activée et adhère à la musique. C’est
pourquoi chanter ou faire de la musique ou même en écouter a tant
d’implications sur le cerveau et sur la personne toute entière. Le
traitement de la musique par le cerveau est désormais connu : Quand on
écoute un thème, la musique agit sur le cortex temporal et l’aire de Broca
(identique à la parole, production des sons) et l’aire de Wernicke( perception
des sons), et fait sentir une émotion car l’amygdale et le cortex
orbito-frontal sont activés. Avoir des émotions façonne le cerveau.
Pour écouter la Chorale chanter Santiano..
4°) « Mon corps vibre et bouge, je bats la mesure,
souvent j’ai envie
de danser comme avant, surtout sur certains rythmes, moi qui
était assez coincée car il fallait garder certaines convenances, je peux
désormais oser ! »
« Pour
moi rester débout pendant une heure à chanter est physiquement de plus en plus
difficile mais cela me démange de bouger». « Pour
moi, entendre un son c’est bien, le
produire c’est encore mieux et créer à partir de sons une mélodie connue et en
rythme, cela rejoint les battements de mon cœur, c’est magique et cela mobilise mon énergie et le mouvement.
Je n’aimerais pas devenir sourde. »
« Quand
je vais chanter, je me réveille mieux et j’ai envie toujours de
chocolat" (rires) indique une autre choriste.
Les
neurosciences montrent que le cervelet est activé
et synchronise musique et mouvement. Le musicien mobilise son
corps en fonction de son instrument et a une excellente coordination motrice
qui fait agir les doigts des mains de façon coordonnée et pourtant
autonome. Le
mélomane lui va battre la mesure avec les pieds, bouger, respirer différemment…
et parfois avoir une envie de danser. L’histamine est le neurotransmetteur
situé dans l’hypothalamus et génère l’éveil (absent quand on dort). Le fait
d’aller chanter mobilise l’histamine, principal centre de l’éveil, et quant au
chocolat il est prouvé qu’il est une source d’histamine comme le thon, les
sardines, le roquefort… N’oublions pas aussi les omega 3, les noix , avocats… donc
avant un concert, un menu stimulant est indiqué !

5°) « La chorale
pour moi c’est rester dans la convivialité, partager et être ensemble. Quand
je chante, je suis en phase avec les
autres, je suis dans un groupe et on
partage des expériences ensemble et après on noue plus facilement des relations
amicales, comme quand je faisais
du sport en équipe. En chantant je suis en empathie avec les autres, je crée un lien social même avec le public et mon
comportement amical envers les autres s’améliore car l’adage le dit bien :
la musique adoucit les mœurs ! »
« Moi,
ce qui m’amuse c’est l’ambiance, énonce une autre résidente, nous avons
des fous rires et chanter reste une joie et c’est contagieux à tel point que
certaines personnes
extérieures viennent renforcer la chorale (exemple de la CCAS de la
mairie) et nous avons enfin des hommes basses et barytons ce qui améliore
l’ensemble et une petite nouvelle centenaire qui vient d’arriver de
l’extérieur ! Quelques personnes des maisons de retraite des alentours
viennent parfois chanter aussi. Nous mettons la barre de plus en plus
haut ! et nous avons même remporté une joute inter-chorales et nous en
sommes fières. Cette ouverture avec l’extérieur est essentielle pour nous
surtout que nous sommes souvent valorisées grâce à nos prestations chantantes. »
« Ce
qui est amusant, c’est que les membres de la chorale constituent un groupe soudé par une activité et respecté par les autres résidents y compris par tout
le personnel".
La
pratique de la musique crée des chemins neuronaux qui sont ensuite reconnus (comme se frayer un
chemin à travers un champ), et ces chemins sont de plus en plus visibles à
force de répéter le passage. (c’est pourquoi il faut travailler !) Et
quand cela passe bien, tous se sentent heureux d’avoir participé à une œuvre collective de qualité.
En
effet la pratique et l’écoute de la musique améliorent la santé et cela permet
de briser la solitude donc d’avoir plus d’empathie pour autrui et donc un
comportement plus positif.
6°) « Participer
à cette chorale, c’est avoir encore des projets et penser
au futur proche, en fait rester en
activité à défaut de rester jeune. Et puis j’aime le risque, jouer sur scène,
me remettre en question et en danger (très relatif), je fais monter mon
adrénaline non ? ». « Moi,
à part les bienfaits personnels déjà indiqués, ce qui me motive c’est aussi de
reprendre des chants parfois oubliés et transmettre
le patrimoine musical qui a entouré notre jeunesse. Certaines
chansons passées sont vraiment de la belle musique. »
En
jouant on puise une énergie physique et psychique qui reste quelques heures
voire quelques jours après, énergie qui n’aurait pas été sollicitée sinon. En
se concentrant et en jouant en public, l’adrénaline intervient aussi (stress
positif).
Lire
la musique, anticiper musique et paroles, se concentrer, être en accord avec
les autres, suivre le tempo et l’accompagnement du piano… tout ceci fait
travailler le cerveau et l’améliore. La
pianiste modifie parfois ses accords (en enrichissant sciemment certains
accords pour habituer les oreilles aux 7èmes et 9èmes) ou module et la
réactivité de tous les choristes est impressionnante grâce à la plasticité du
cerveau. Le cerveau en pleine possession de ses moyens réagit ainsi en temps
réel comme à l’apparition d’un danger.
 |
| Madame TOUROUDE dirige la Chorale. |
7°) « Je ne pensais pas
que la musique demandait tant de travail, d’efforts, de concentration et de discipline
pour faire quelque chose de propre. Je ne raterais pour rien au monde nos
répétitions et pourtant je ne suis plus très en forme. »
« Ce
qui me plait c’est que nous travaillons
sérieusement sans cesse de nouveaux morceaux pour avoir un répertoire conséquent (plus de
70 thèmes), et on les adapte à nos
possibilités qui sont limitées et on répète toutes les semaines, on joue pour toutes les occasions
et en quelques années nous progressons. »
« Moi
aussi, j’aime
le travail bien fait. J’ai travaillé très tôt et j’ai pris ma
retraite très tard et j’aime bien travailler désormais la musique ! Ancienne
sportive, d’ailleurs je vais aussi à la séance de gym, je me bats avec mes limites qui avec
l’âge se réduisent mais si la lenteur est la marque de l’âge, on chante parfois
des thèmes enlevés. »
La
musique est l’art des sons et le système auditif dans un premier temps entend tous
les sons qui sont des ondes sonores qui suivent le trajet : oreille,
tympan, osselets, cochlée avec ses cellules ciliées, nerf auditif (transmise en
impulsion électrique) puis cortex cérébral.
Le
musicien stimule son système auditif qui entend, contrôle ce qui permet de
modifier en temps réel la production de sons. L’intensité
du son (quand on joue fort !) et sa fréquence (hauteur du son) suivent ce
parcours et donnent une connotation émotionnelle positive (musique aimée
souvent consonante et culturellement écoutée : j’adore ce thème) ou
négative (dissonances désagréables, musiques trop différentes de sa culture).
Le rythme est aussi essentiel pour le tonus.
Si
la musique est familière et les sons vont vers les régions de la mémoire, c’est
à dire dans le cortex frontal et l’hippocampe (lieux où sont stockés les
souvenirs) cela stimule. C’est fou comme de nombreuses musiques quand on les
rechante sont imprimées et datées voire articulées à des événements et des
souvenirs précis, voire à un plat. Tout
ce processus est réactivé en permanence grâce à une régularité des répétitions
ce qui renforce le dynamisme collectif.
La Chorale chante les enfants du Pirée.
8°) « Nous avons des animations, complète
une autre choriste mais la chorale rythme notre vie et le mercredi jour de la
répétition, malade ou non, nous faisons un effort sur nous mêmes pour dépasser nos
maladies et usures du temps et les jours de concerts, nous nous pouponnons
toutes coiffées (le coiffeur fait des affaires !) et habillées pareilles
(cela me rappelle ma pension de jeunes filles !) Nous donnons le
maximum et nous rajeunissons momentanément
de 20 ou 30 ans et c’est bien agréable ! et puis je suis de bonne humeur
après avoir chanté. » Comme le disent Spinoza mais aussi Alain « on
ne chante pas parce qu’on est heureux mais on est heureux parce qu’on
chante »
Le
musicien peut ralentir la maladie et le vieillissement avec son art. C’est
le secret du maintien de la jeunesse, un élixir désormais reconnu qui permet de garder plus longtemps ses facultés
d’énergie vitale, de capacités motrices, de mémorisation, et donc de lutter
contre le vieillissement cognitif. Le
fait d’organiser son emploi du temps est excellent pour le cerveau.
La
sérotonine est liée à la bonne humeur et entraine un mieux être.
9°) « Moi ce que
je sais, c’est que depuis que je chante en chorale depuis 3 ans, je mémorise mieux. Quand je chante, ma
mémoire est stimulée et je me rappelle des souvenirs enfouis que je croyais
oubliés". « J’ai
eu du mal au début à mémoriser musiques et paroles mais j’ai réveillé ma
mémoire qui s’endormait et je réussis mieux mes mots fléchés et questions pour
un champion, je suis plus stimulée. »
La
musique donne une compétence cognitive, qui développe des activités cérébrales,
des connexions entre les synapses des neurones qui améliorent la mémorisation
et en fait maintient
la plasticité du cerveau,
ce qui a été maintes fois démontré. L’évolution
de l’homme est due à son cerveau qui s’est développé (3 fois plus gros que
notre ancêtre préhistorique). Ce
sont les interactions, les connexions qui renforcent les neurones et qui étant de
plus en plus gros et rapides font « du haut débit » !
Si
les neurones ne servent pas, il sont abandonnés, et à partir de 65 ans leur nombre
décline. C’est pourquoi, il faut avoir des émotions raisonnables, et s’en
servir par différentes activités intellectuelles, de mémorisation, de
concentration, d’anticipation, d’apprentissages différents…Mais
il faut que le travail et le plaisir aillent de concert (sans jeux de mots) et que
le circuit de récompense soit mobilisé.
Le
musicien a une mémoire
exceptionnelle notamment procédurale où
les doigts reprennent ce qui été travaillé par un exercice quotidien. Ainsi
par exemple, la pianiste et responsable de cette chorale, a la DMLA ne peut
plus lire la musique mais joue par cœur et entend toujours par contre les fausses
notes ! Malgré son grand âge, elle connaît plus d’une centaine de morceaux
par cœur ….L’hippocampe
siège de la mémoire est
vraiment beaucoup sollicité. L’acide
glutamique présent dans beaucoup d’aliments notamment les tomates, crustacés,
fromages permet d’améliorer la mémorisation et la capacité d’apprendre et est
un excitant important des neurones.
Est-ce
que le menu donné à la chorale est une clé du dynamisme de cette chorale ?
10°) « Je suis fière de cette chorale qui
génère un enthousiasme communicatif dans
un foyer de personnes âgées où il n’est pas évident de créer une activité stimulante.
La
chorale est devenue un moment fort de
nos activités et de notre image » dira la directrice. « Lors d’un concert, les enfants
découvrent que leurs mères chantent ! des variétés comme du classique et
en restent pantois … c’est assez amusant et dynamisant. Souvent
notre pianiste joue le matin sur son piano dans le salon du Debussy, Schubert …
et tous accourent pour écouter et cela finit en « bœuf » sur des
chansons anciennes en véritables apéritifs concerts ! »
« Ce
qui me plait, lui répond une résidente, c’est que notre chorale n’est pas une
animation de l’extérieur subie mais une activité interne choisie. Nous avons la chance
d’avoir parmi nous une professeure de musique, pianiste, qui nous fait des petits
concerts et qui a dirigé des chorales d’enfants et d’adultes toute sa vie… donc
une professionnelle rigoureuse mais pédagogue qui tire de nous des choses insoupçonnées et
nous fait progresser. En plus sa sœur, ancienne prof de musique aussi, vient
nous aider. »
Le fait d’auto-organiser ses activités rend actifs
au lieu de consommer des activités imposées de façon passive, et le cerveau est
beaucoup plus sollicité en amont : dynamisme, créativité,
organisation, communication… bien avant de chanter.

11°) « Peu de
choristes connaissent la musique dans cette chorale « indique la
fondatrice et responsable de cet ensemble. « Timides, n’ayant pas eu d’éducation
musicale, il a fallu peu à peu chanter des choses simples et connues. La
musique est
subjective et produit de notre culture et
de notre écoute permanente. C’est pourquoi nous ne travaillons que des chansons
qui ont du
sens pour eux : variétés de
leur jeunesse ou airs connus classiques. La
musique est un langage
universel mais surtout culturel quand on se rencontre avec des classes
d’enfants dans des rencontres intergénérationnelles, nos vieilles chansons et
les tubes classiques célèbres leur sont inconnus". « C’est
vrai, indique un choriste, nous avons toujours baigné dans différentes musiques
qu’on nous a assénées, qu’on a aussi choisies et comme nous sommes un groupe
homogène d’âges comparables avec les mêmes repères, appartenant à la même culture,
au même pays, à la même époque, nous avons dans
la tête et dans nos cœurs les mêmes mélodies et celles-ci ont du sens pour
nous quand on les chante. »
La
musique langage universel et culturel.
Tous
les peuples de tous temps ont fait de la musique : c’est un langage essentiel
pour l’homme et universel. Bien
sûr il y a des invariants
musicaux de base (des sons qui
font des notes différentes qui montent ou qui baissent créant une gamme, un
style de mélodies, des fréquences graves et aigues, des rythmes lents et
rapides, des rythmes simples ou complexes répétés et connus, la mesure qui
donne une pulsation et qui génère le mouvement voire la danse, des sonorités
d’instruments, vents, percussions, cordes, chant….) tout ceci est commun à tous
les hommes sur terre. Mais
une fois cette généralité énoncée, les musiques sont plurielles : tons, demi-tons, quarts de tons,
modulations, gammes, harmonie, contrepoint, instruments, traitement du son et les
déclinaisons de la musique des hommes sont très différentes et culturelles.
L’acculturation
musicale est fondamentale.
Nous
avons tous vécu dans un environnement musical culturel spécifique, nous
naissons en tant qu’être humain musical car notre première expérience est
d’entendre le rythme d’abord (la voix de nos mères). A un mois de grossesse les
neurones apparaissent et le bébé nait avec un capital de 100 milliards de
neurones ! Puis
viennent les mélodies simples quand on est enfant et qui sont mémorisées donc
un premier
formatage culturel sur une gamme
de sons et de rythme.Toutes
les musiques du monde se sont construites différemment, et entrainent un plaisir
pour une population donnée . Ainsi un mélisme arabe avec des quarts de
tons, une gamme tonale pentatonique asiatique, une harmonie occidentale ou des
rythmes africains complexes seront perçus différemment (admirés voire
repoussés). Un
amateur de jazz moderne admirera un solo basé sur des accords altérés alors
qu’un autre musicien trouvera cela inaudible et désagréable.
Ce qui est sûr
c’est qu’écouter et voir cette chorale puis entendre les témoignages des
choristes donne une leçon de vie bien stimulante. Pour plus de
connaissances sur les neurosciences et la musique voir les écrits des
professeurs Lemarquis, Bigand etc…
 |
Reportage de notre envoyé
Don José. |






















































.jpg)